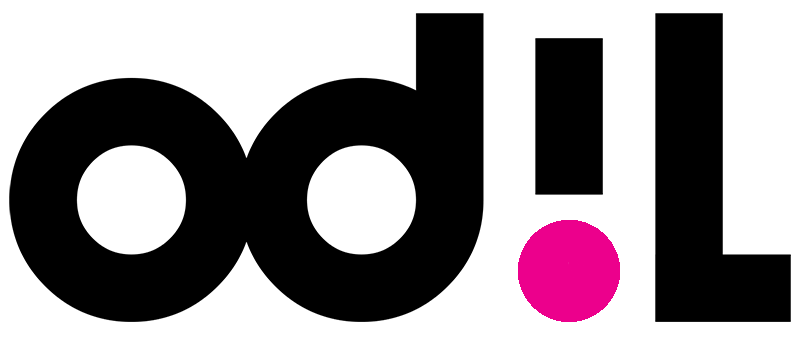Un guerrier solitaire blessé et son chien, Michel Serrault marchant dans les ruines brûlées de son domaine, un homme et son enfant poussant un chariot, les enfants d’une école primaire revenus à l’état sauvage, une bande de motards punks aux regards bovins, le désert, la route… Habiter les ruines, c’est vivre dans un monde post-apocalyptique.
Les œuvres qui s’inscrivent dans ce genre décrivent une société détruite et la vie des survivants parmi les vestiges de la civilisation. Les raisons de l’anéantissement sont malheureusement légions : la guerre, un virus, des extra-terrestres, la surexploitation des ressources, la destruction des éco-systèmes, ou tout simplement la bêtise et l’incompétence des gens au pouvoir.
Dans l’excellente comédie satirique Dr Folamour de Stanley Kubrick (1964), parfait film « pré-post-apo », l’absurdité des décisions prise par les politiciens et l’armée conduit le monde à la catastrophe nucléaire. Et le générique final annonce ce qui va suivre…
Parce que, quand l’humanité est renvoyée à la préhistoire de son développement, elle retombe avec une facilité confondante dans la barbarie, les guerres tribales, les abus de pouvoir et l’abandon de toutes valeurs éthiques et morales.
Les questions restent alors : est ce que l’Histoire n’est qu’un éternel recommencement ? L’Homme va t’il enfin apprendre de ses erreurs ?
LA MATRICE DU GENRE
Pour Mad Max, (1981) de Georges Miller, la vie s’est arrêtée quand une bande de pillards a tué sa femme et son enfant. Max Rockatansky, l’un des derniers représentants de la loi et de l’ordre, devient un être vide, vivant pour se venger. À travers lui, les derniers vestiges de la civilisation s’effondrent. Dans Mad Max 2 de Georges Miller (1981), il n’est plus qu’un fantôme solitaire, une ombre du passé, hanté par ses démons. Un survivant qui a perdu tout espoir en l’Homme.
Ses errances vont l’amener à rencontrer une communauté retranchée dans une station d’extraction de fuel, qui suscite la convoitise d’une tribu de barbares dirigés par le terrible Humungus. À leur contact, Max comprendra qu’on ne survit pas seul et que la force réside dans l’union. Max, à sa façon, va s’attacher à eux et les aider à fuir… Mad Max 2, je l’ai saigné jusqu’à l’os. C’est un chef d’œuvre instantané. Personne n’a surpassé ce film (à part George Miller lui-même avec Mad Max : Fury Road). Son réalisme rend le Wasteland totalement crédible. Le dynamisme de sa mise en scène, la brutalité des cascades et de l’action et son rythme incroyable vous scotche au siège jusqu’à sa dernière image, qui inscrit définitivement le personnage dans la mythologie du cinéma…
Mad Max 2 définit l’essence du genre et nombreux sont les films qui essayeront d’arriver à sa cheville, voire de lui chatouiller les mollets. Pourtant, plutôt dépressif, violent et sombre, le post-apo ne porte pas à la franche rigolade. Heureusement, on peut toujours compter sur des producteurs aux petits bras et aux grands appétits pour s’engouffrer dans la manne financière et accoucher d’une superbe série de nanars qui marqueront les annales du cinéma d’exploitation. Pas pour les mêmes raisons.
En 1987, Bruno Mattei réalise les rats de Manhattan, nanar stratosphérique dans lequel tout est apocalyptique. Mise en scène, jeu d’acteurs, effets spéciaux… Un grand moment de n’importe quoi. À voir absolument. La France n’est pas en reste grâce à notre Johnny national. Celui-ci s’est illustré en guerrier péroxydé sous anxiolytiques dans le non-sens absolu qu’est Terminus, film franco-allemand de Pierre William Glenn de 1987. Et pour les cinéphiles pervers qui voudraient creuser la voie du post-apo rigolo : Allez jeter un œil au fabuleux site Nanarland.
Un souvenir traumatisant de ma jeunesse dans le genre : sorti l’année précédente à Mad Max 2, soit en 1981,
Malevil, de Christian de Chalonge, est tiré du roman de Robert Merle sorti en 1972. Le film débute par l’évocation d’un paradis campagnard dans lequel vit une poignée de personnages ; interprétés par Michel Serrault, Jacques Villeret, Jacques Dutronc et Jean-Louis Trintignant (dans un rôle de salaud de première bourre) en tête. Une catastrophe totale a lieu. Les personnages y survivent parce qu’ils sont enfermés dans une cave au moment des faits. Ils émergent dans les ruines de leur paradis. Un paysage de désolation qui leur rappelle constamment d’où ils viennent et ce qu’ils ont été. Ce paradis ravagé, recouvert de cendres, est sublimement anxiogène. En abolissant les règles en vigueur dans le monde d’avant, le groupe emmené par Michel Serrault va se réinventer et s’adapter pour survivre. Sans avoir la dynamique cinétique et le sens du spectacle de la mythologie de Mad Max, Malevil reste un pendant français assez captivant du film post-apocalyptique.
Si les films post-apocalyptiques nous mettent en garde – s’accrocher à la morale et aux lois du passé c’est se condamner – ils nous donnent aussi des pistes pour survivre à la catastrophe : face à un événement traumatique, parler c’est commencer à reconstruire l’humanité.
Poser des questions, discuter, comprendre… Bref tisser des liens.

SORTIES DE ROUTE
Le cinéma n’est pas le seul à avoir investi les ruines post-apocalyptiques. Dès 1826, la littérature s’empare du sujet : Mary Shelley écrit un roman fondateur pour le genre : The Last man (le dernier homme) qui raconte la chute de l’humanité à partir de 2073 jusqu’à 2100. Il infusera probablement une partie de l’imaginaire post-apo puisque le meilleur ami de Verney, le dernier homme, est un chien – Mad Max 2 évidemment mais aussi Apocalypse 2024de L.Q Jones ; même si celui-ci est d’abord tiré de la nouvelle A boy and his dog d’Harlan Ellison publiée en 1969. En 1901, paraît The Purple Cloud (Le Nuage pourpre) de Matthew Phipps Shiell, dont s’inspire le film The World, the flesh and the devil (Le monde, la chair et le diable), réalisé par Ranald MacDougall (1959). Un petit bijou cinématographique au réalisme assez saisissant préfigurant les adaptations cinématographiques d’un autre grand roman de Richard Matheson paru en 1954 : I am Legend (Je suis une légende), qui sera adapté trois fois au cinéma en 1964, 1971, 2007. The world, the flesh and the devil mérite d’être redécouvert tant il offre des images saisissantes d’un New York déserté. Il aborde également des thématiques typiquement ancrées dans le genre post-apo : comme la nature égoïste de l’Homme et son incapacité profonde à apprendre de ses erreurs. Toutefois le film reste plein d’espoir et assez audacieux puisque dix ans avant La nuit des morts vivants de George Romero, les deux survivants sont un homme noir (le grand Harry Belafonte) et une femme blanche (Inger Stevens).
Suit en 1935, le roman Quinzinzinzili de Régis Messac, qui décrit la disparition quasi totale de la race humaine suite à une guerre.
Les survivants : un homme, une fillette et quelques garçons attardés se réfugient dans une grotte de Lozère et vont réinventer la guerre, la géométrie, l’amour et un dieu étrange et puéril : Quinzinzinzili. L’histoire d’un pessimisme effroyable quant à la condition humaine reste d’une ironie féroce et peut être considérée comme visionnaire (la guerre qui vient). Un précurseur auquel, Malevil, Sa majesté des mouches, le célèbre roman de William Golding (1956), et L’école emportée de Kazuo Umezu (1972), manga génial et incroyablement brutal, doivent tous, certainement, une part de leur inspiration. En 1943, le roman Ravages de René Barjavel, se déroule en 2052 et raconte le naufrage d’une société technologique suite à la disparition soudaine de l’électricité – une vision qu’on pourrait rapprocher de la théorie d’Olduvai de Richard Duncan(1), puis la reconstruction d’une nouvelle civilisation.
Le roman est une critique de l’asservissement de l’homme au progrès, au même titre que l’étaient à l’époque le Métropolis de Fritz Lang ou Les temps Modernes de Charlie Chaplin. Barjavel ne décrit pas un retour idyllique à la nature : la chute de la civilisation moderne se concrétise d’abord par un retour à la barbarie, aux pillages et aux meurtres. Le constat est sans appel : les ruines de la civilisation s’accompagnent de l’abandon de tout comportement civilisé. Et donc en 1972, L’école emportée, reste un des grands chocs de ma vie de lecteur. Sans explication une école primaire japonaise se retrouve transportée dans un désert hostile. Face à la démission des adultes, qui plongent dans la folie, la violence et le désespoir, les enfants vont devoir s’organiser en tentant de recréer une micro société pour survivre. L’histoire est d’une férocité sans nom pour ces enfants livrés à eux-mêmes. Rien ne leur est, et ne nous est, épargné. Toutefois l’histoire porte un message intemporel et pertinent d’une force phénoménale. Un chef d’oeuvre de la bande dessinée sans aucun doute.
Sur les routes désertiques du genre post-apocalyptique on trouve à boire et à manger. Le genre a engendré lui-même des sous-genres, le film de zombie par exemple, et ces dernières années, les films et séries dans un univers post-apocalyptique se sont multipliés jusqu’à l’overdose. Face à la crise écologique qui n’a pas fini de durer, la pandémie, il semble que les films et séries nous alertant sur la chute probable de la civilisation envahissent les écrans. Ce n’est pas la série The Walking Dead et ses spin off qui me contredira. Toutefois la question n’est plus d’envisager le pire, pour mieux s’en prémunir mais bel et bien de se préparer à son arrivée imminente et d’imaginer comment y survivre. La résilience face à l’effondrement. Voir l’excellente série L’Effondrement (2019) du collectif les parasites. Des nouvelles thématiques qui rejoignent le travail du collapsologue Pablo Servigne. Pour survivre, nous devons abandonner les principes de concurrence, de compétition et de prédation comme seule possibilité de relations inter-espèces et nous tourner vers l’entraide et la coopération.

MAINTENANT ÇA Y’EST !
L’effondrement entamé depuis quelques temps s’est précipité cette année. On peut le dire : nous habitons déjà dans les ruines du capitalisme… Le pessimisme n’est plus de rigueur. Il est là, s’invite à notre table, comme la mort dans Le Septième sceau (Ingmar Bergman,1957), pollue les murs
des réseaux sociaux jusqu’à en faire des vieux trucs dégoulinants de tags dégueulasses dénonçants tout et n’importe quoi. Dans ce merdier, comment survivre sans abandonner l’éthique, l’altruisme, la cohésion et l’entraide des sociétéshumaines ? Peut-être, en souhaitant le retour d’une forme d’éthique esthétique… En appelant à la résilience, au vivant, à la créativité, au mouvement. En rejetant la sédentarisation des idées. En abandonnant le pessimisme de fin de cycle et, comme La Horde du Contrevent, en reprenant toujours le chemin de la Trace. En appelant un retour rapide de la culture.
Parce que l’écriture, la musique, le cinéma, la peinture, la photo, la danse, la bande dessinée sont les supports de la mémoire de l’humanité. Ils ne sont pas la réalité, ils sont bien plus que cela. Ils sont notre capacité à imaginer et façonner notre rapport à la réalité. Ils construisent notre lien avec l’humanité toute entière.
Ils sont les ruines poétiques du monde.
Le cinéma est une expérience post-apocalyptique, parce que : « C’est un art de « passage » dans nos vies, c’est-à-dire un art de la transition et un dispositif de spectacle à peine moins éphémère que la vie humaine » (dans Du monde et du mouvement des images, Jean-Louis Schefer -1997).
Parce que regarder un film, c’est se projeter dans la ruine d’une histoire qui tout en se déroulant au présent, du moins dans l’instant, nous raconte toujours quelque chose du passé. Une histoire qui tend à se dissoudre une fois le film terminé, ne laissant dans notre esprit que des traces mémorielles, des images fugaces, des sensations, des rémanences émotionnelles.
Ces traces s’impriment en nous, deviennent une part de notre réalité et aident à la construction de notre personnalité. Regarder un film, c’est voir les ruines comme autre chose que des objets inertes ; c’est comprendre qu’elles ne sont que le reflet d’un mouvement perpétuel, des propositions poétiques qui contiennent les germes de leur destruction. C’est habiter les ruines et se figer dans leurs contemplations nostalgiques ou décider de s’extraire du monde ancien. Être au carrefour des restes du passé et des possibles du futur.
Triste constat que de passer de l’expérience collective d’un instant de partage immatériel au choix solitaire d’un produit de consommation sur une banque de données de fiction. Bon. Continuons à tailler la route.

HABITER LES RUINES
En 2006, sort le chef d’oeuvre : Les fils de l’Homme d’Alfonso Cuaron (adapté du roman de P.D James sorti la même année). L’histoire d’une société humaine en déliquescence suite à son infertilité. Voilà dix-huit ans qu’aucun enfant n’est né. Le monde a perdu espoir. Sans enfant, pas d’avenir. Théo Faron (Clive Owen), un homme désabusé, va se voir chargé de protéger une jeune réfugiée enceinte, Kee. Elle devient un enjeu capital pour l’avenir. Le film propose un avenir sombre et réaliste. L’infertilité devient la métaphore de la perte d’espoir des hommes. Le bébé devient le symbole d’un possible renouveau.
L’un des films post-apocalyptique les plus dépressifs sort en 2009 : La route de John Hillcoat. Un homme apprend la survie à son fils dans un monde où règnent la violence et le cannibalisme. Le film est lui aussi adapté du roman de Cormac Mac Carthy paru en 2006. Dans ce film, teinté d’un désespoir absolu, l’enfant représente toujours les valeurs d’une civilisation que l’homme cherche à protéger à tout prix.
Un espoir. Toutefois, la fin reste totalement ambigüe.
Light of my life (2019) de Casey Affleck, dernier film indépendant post-apocalyptique, sorti chez nous en catimini durant l’été 2020 nous raconte l’histoire touchante d’un père prêt à tout pour protéger sa fille dans un monde où les femmes ont été éliminées par un virus. Pour protéger sa fille, le père la fait passer pour un garçon. Les méfaits de la pandémie sont évoqués par touches subtiles et réalistes. Le désarroi et la volonté du père face à l’éducation de sa fille, qui doit l’éduquer comme un homme pour qu’elle survive dans un monde d’hommes tout en lui permettant de trouver son expression personnelle, en font une œuvre intimiste, touchante et juste. Et si les dernières images restent dans la lignée des précédents films, elles ouvrent une fenêtre plus précise sur l’avenir de l’humanité. Il sera féminin ou ne sera pas.
Alors quoi ? Dans les ruines du monde, n’y a t-il que l’espoir, l’utopie d’un oasis, d’une terre promise, aussi faible soit-il, pour voir perdurer ou recommencer l’humanité ?
Le film qui synthétise avec le plus d’intelligence le cinéma post-apocalyptique et l’emmène sur de nouvelles perspectives est sorti en 2015 et s’appelle Mad Max : Fury Road du génie Georges Miller. Parce qu’au delà des images, de la mise en scène furieusement cinétique et du pur plaisir de spectateur, il y a dans Mad Max : Fury Road le passé et le futur du cinéma. C’est d’abord un hommage vibrant à son histoire ( du Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein à La Nuit du chasseur de Charles Laughton). À lui seul, c’est un condensé du cinéma populaire et spectaculaire qui intègre avec un brio inégalé toute sa puissance expressive.
Mais Mad Max : Fury Road propose aussi une vision et une réflexion puissante sur le monde actuel. À la fin du film apparaît cette phrase :
« Où devons nous aller, nous
qui errons sur cette terre désolée
en quête du meilleur de nous-mêmes ?
– Le premier Homme de l’Histoire. »
La réponse, c’est le film qui la donne. Il n’y a plus nulle part où aller. L’espoir, vu comme un oasis lointain, une terre promise est un leurre, un mythe. Une erreur. Le désert est partout. Le Wasteland, c’est ici et maintenant. C’est ce qu’apprend Furiosa dans sa tentative de rejoindre la Terre Verte. Fuir avec l’espoir de trouver mieux ailleurs, c’est tout au plus retarder le moment ou le désert vous rattrapera… Ce qu’il conviendrait de chercher, c’est Max qui le dit, c’est la réparation et par là, une forme de rédemption. Il faut revenir à l’origine, la Citadelle, parce que c’est là que se trouve la terre promise. Prisonnière des oligarchies théologiques et politiques dont il faut se défaire. La terre promise est en nous, c’est notre capacité à forger des alliances et fortifier des amitiés pour réparer le monde. Et si la dernière image du film laisse encore une fois planer un doute sur l’avenir du monde ; tout reste fragile, le choix de Max paraît rejoindre celui de La Horde du contrevent de Alain Damasio.
« …après avoir profité des mains tendues de la Horde, il faudrait en saisir la poigne et en grossir les rangs, s’extraire des ruines du monde ancien et parier sur l’énigme d’une vie tout entière faite de vent, de mouvement, d’intelligence cinétique, se montrer digne de consentir à une « terre […] tissée de rafales »
La Horde du contrevent- Alain Damasio (p. 624).
dont la mouvance serait productrice de matière… »
Entre Mad Max 2 et Mad Max : Fury Road. La même logique de révolte, la même logique de combat mais en 35 ans, Georges Miller a affuté son regard et sa réflexion. La boucle est bouclée.
Alors Habiter les ruines ? Oui, bien sûr mais pour les réparer.
(1)La théorie d’Olduvaï est une hypothèse énoncée par Richard Duncan en 1989 puis développée par la suite. Elle postule que la durée de la civilisation industrielle sera de 100 ans. Ayant commencé selon son auteur en 1930, elle devrait donc se terminer en 2030. Elle s’appuie sur un seul indicateur : le rapport entre la quantité mondiale d’énergie produite (donc consommée) et la population humaine. Elle décompose l’évolution de la civilisation industrielle en trois phases distinctes : la phase pré-industrielle, la phase industrielle puis la phase post-industrielle. Selon les données historiques, le déclin de la civilisation industrielle a déjà commencé puisque le pic de consommation énergétique par habitant a été atteint en 1979. Sources Wikipédia.
Tony Gagniarre – 2021 – PAPIER #1 – Habiter Les Ruines
Illustration article : Tony Gagniarre – 2021