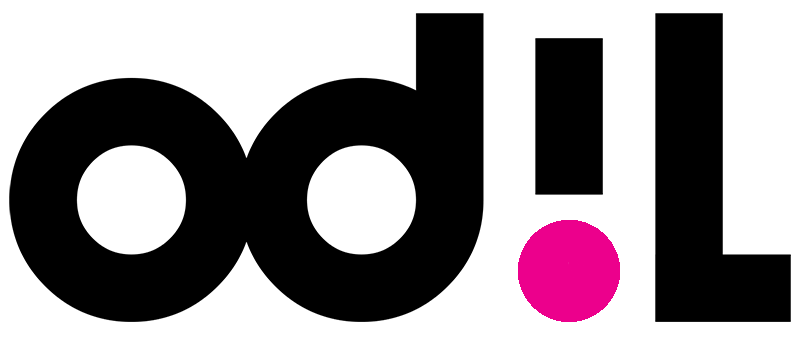Focus sur la création cinématographique alternative avec le court-métrage 100% montcellien, Le jour où Papa a tué le monstre.
Le réalisateur Benjamin Burtin revient sur l’origine du projet et sur la possibilité de faire des films en dehors des parcours de prod’ classiques.
Qui es-tu ?
Benjamin Burtin, touche à tout autodidacte, fondateur de la société Dahiro, membre du collectif Labozero. Originaire de Montceau-les-Mines, j’y suis resté et j’y construit tout ce que je peux.
J’ai commencé par la musique, le rap au micro et à la composition, le punk aussi, derrière la batterie. Depuis des années je suis intervenant en écriture et vidéo dans divers établissements, notamment scolaires. Aujourd’hui je réalise des reportages, documentaires, clips, pubs au sein de ma boîte et des fictions à mes heures perdues.
Tu nous parles de ce court-métrage ?
A l’origine, j’avais envie de réaliser mais pas un truc que j’avais écrit.
J’ai fait appel aux copains et Mickaël Pillisio avec qui on s’était promis de travailler ensemble, ma proposé une idée de scénario. On y a bossé tous les deux, on partagé nos visions, nos esthétiques puis on s’est séparé les rôles, lui devant la caméra, moi derrière.
Entre ce que Mick avait écrit à la base et ce que j’en ai fait, il y a un écart.
On a pas le même âge (il est bien plus jeune), et mes préoccupations de papa quadragénaire l’ont un peu emporté sur le sens du film.
Certains y verront un récit sur le fils, j’avoue avoir plus traité du père, de la paternité. Des difficultés à passer à l’âge adulte, à tuer son propre monstre.
Sinon c’est un film au récit simple, on a travaillé sur les sensations, une esthétique rurale, vaguement Midwest Américain.
Faire un film auto-produit en Saône-et-Loire, c’est un défi d’illuminé ou le lieu de tous les possibles ?
Tout ce que j’entreprends est un défi, c’est mon moteur.
Je ne connais pas la méthode officielle pour faire des films et j’avoue que passer par les voies académiques ne m’intéresse que peu, du coup, je ne sais pas réellement ce que je perds à m’autoproduire, ni réellement ce que je gagne. C’est vrai que je n’ai pas trop l’impression que la Saône-et-Loire soit à l’avant poste de la production cinématographique, et le fait que les financements ne soient réservés qu’aux professionnels et non aux assos n’arrange pas les choses.
Pourtant le territoire a des atouts avec la campagne toute proche, les paysages industriels, etc…
En attendant faire un film avec l’équipe Labozero est toujours une aventure unique et pleine de rebondissements. On s’invente en permanence et peut-être que se conformer à faire des films d’une manière plus professionnelle nous contraindrait trop. Pour faire simple, là où j’en suis en ce moment, l’autoproduction me convient parfaitement.
Qu’est – ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?
De faire progresser ma société, parce que ça me fait manger et que du coup j’ai l’esprit libre pour lancer de nouveaux défis.
De progresser moi-même dans la réalisation, pour réussir à raconter au mieux ce que je veux dire.
Et forcément la santé pour m’occuper des miens, simplement.
Ah oui, faudrait aussi que grandisse ODIL, parce que tu l’as pas dit ça, que j’étais aussi engagé là-dedans et qu’on faisait de l’autopromo 😉