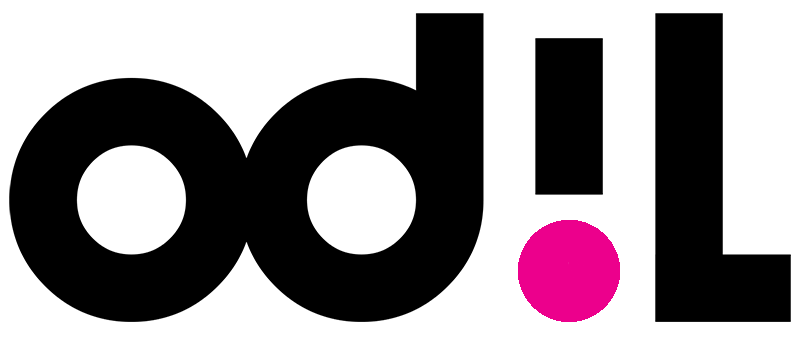Ok, on a tous maté des films en V.O.D. Retapé dans notre collec’ de DVDs ou Blu-Rays. Essoré Netflix, qui s’en félicite, et les autres plateformes (non, j’vais pas toutes les citer). Mais le constat reste le même : on ne sait pas quand on pourra retourner au cinéma. Et dans quelles conditions ? Ça pourrait paraître anodin : il va y avoir plus grave. C’est vrai, il y aura plus grave. Mais si on nous enlève même le cinéma, comment on supportera le plus grave. Parce que la salle de cinéma est essentielle ! C’est un crève-coeur de nous l’interdire. Une punition insensée. Soyons clair, un film se vit au cinéma. Il se consomme sur les écrans, parfois il se déguste. Et il se méprise sur smartphone. La salle de cinéma, ça a toujours été mon refuge, mon Shell Beach, mon Avalon… Le lieu qui m’a vu grandir et dans lequel j’ai passé le plus de temps, au même titre que ma chambre, mon bureau, la salle de bain ou… les toilettes.
Que voulez-vous, j’aime les vieux sièges dégarnis qui ont vu passer un nombre incalculable de fesses. Tellement que tu peux pas test. Les salles minuscules : toujours plus grandes que mon salon, qui sentait l’humidité, la moquette poussiéreuse et l’urine. L’ambiance parfaite pour découvrir le Bad Lieutenant (Abel Ferrara).Et quand la lumière s’éteint, l’excitation du gamin dans Panic sur Florida Beach (Joe Dante) est toujours présente. Encore aujourd’hui.

J’aime l’expérience de la transe, comme le dit Gaspar Noé. Le voyage mental, émotionnel et physique. Se perdre dans la dernière demi-heure de 2001 (Stanley Kubrick). La confusion qui fait place au mystère puis au besoin impérieux de le résoudre. Comme comprendre Twin Peaks en regardant Fire Walk with me (David Lynch). Et le choc, le putain de choc, en suivant Mickey Rourke dans Angel heart (Alan Parker), sa recherche de la vérité, son désarroi quand il la trouve.
J’aime quand tu captes le mystère derrière l’Echelle de Jacob, le changement de perspective. Les vagues d’émotions collectives pendant Rocky 3. Mieux que la drogue, moins nocif et plus dévastateur, le cinéma me rend A toute épreuve (John Woo) et je sors de la salle comme un dingue. Vivant, intelligent, plus grand, plus beau, plus fort… Alors que quand j’éteins la télé, ben, j’vais me coucher.
Ces films m’appartiennent et je leur appartiens. Ils ne sont plus des oeuvres vaguement amusantes qui semblent avoir distrait un temps de ma vie. Ils deviennent un souvenir personnel, une émotion gravée et un moment capital de mon existence. Quand je les redécouvre des années plus tard je peux penser : ils m’ont volé un souvenir ou bien c’est encore mieux que ce que j’avais perçu. Mais c’est comme retrouver un vieux pote, ça reste un moment intense et précieux. Parce qu’au cinéma, le film est une force de frappe. Il s’imprime dans ton existence, se mélangeant à toutes les expériences qui ont fait de toi ce que tu es.
Comme le premier baiser avec la femme que t’aimeras toute ta vie.
Les nuits déchirées à déchirer les murs à la fat cap, enivré par l’odeur de la Montana.
Une grosse patate dans ta gueule qui te confirme que tu vaux beaucoup moins en baston que tes héros de cinéma.
Les bancs, les terrasses, les rues de ta ville, les potes et tous ces moments où il ne passe rien d’autre que le temps et les joints.
Le premier morceau de rap qui identifie la musique qui rythmera ton existence ; parce que quoique tu fasses elle s’est imprimée comme un tatouage.
Péta tout ce que tu peux dans les magasins, les videurs à esquiver ; les resto-baskets et courir comme un dératé ; courir jusqu’à poser une galette, se cacher dans un sous-bois, perdre ses potes et les retrouver dans un éclat de rire. Se prendre pour un boss.
Se faire braquer par des militaires parce que t’es allé explorer un terrain de manoeuvre à 3h00 du mat’, finir en GAV. Ne rien prendre au sérieux parce que l’humour est un ciment dans le chantier de nos vies.

Avoir vu Les guerriers du Bronx (Enzo G Castellari) au ciné et te dire en rigolant que si ils l’ont fait, tu peux le faire. Avoir de l’ambition même sans moyen. Et aussi étrange que cela puisse paraître, que ce film te donne encore plus envie de te lancer que découvrir la puissance opératique de la Trilogie du Parrain (Francis Ford Coppola). Et pourtant, je vénère ces films. Les concerts qui dilatent ta présence dans la multitude ; tu t’oublies dans la musique jusqu’à ce que ton t-shirt tripé de sueur te rappelle à l’ordre. Quand raconter The Indian Runner (Sean Penn) à ton frère te permet de recoller les morceaux d’une relation qui s’effilochait. La détresse qui glace ton corps un soir où tu te fais braquer sur un parking paumé par un taulard ; comme les truands de Réservoir Dogs (Quentin Tarantino) se braquant mutuellement, t’envisages sérieusement la possibilité de disparaître comme un connard. Un lendemain matin pâteux d’une soirée en festoche, quand tu t’extirpes mollement de ta tente pour partir à la recherche d’une bouteille d’eau. Errance dans un paysage apocalyptique ; est-ce-que tu as dormi 28 jours ? (28 jours plus tard de Danny Boyle).
La découverte d’un vidéo-club comme le trésor des Goonies (Richard Donner), le rêve devenu réalité, les films rangés par réalisateurs. Quand tu découvres le trésor et que tu l’achètes obligatoirement, même si il est en VO japonaise sous-titré en Anglais. Pas grave. Tu vas enfin pouvoir mater Tetsuo (Shynia Tsukamoto) et te prendre la méchante baffe que t’es venu chercher. La résignation face au monde du travail quand tu comprends que tu seras la merde de ce monde prête à servir à tout puis la colère, l’envie de Fight Club (David Fincher). La délicieuse attente d’un film que t’as rêvé mille fois dans les magazines que tu peux enfin voir.
La folie en matant Police Story (Jackie Chan) ; un autre monde accessible d’acrobates déglingués, repoussant les limites humaines, le bonheur de l’action pure, la dynamique cinétique, le smile collé sur ton visage aveuglant tout le reste le temps d’un retour au bercail. Se bagarrer avec son frère dans la rue en rejouant Bruce Lee, Jackie Chan. L’inquiétude de découvrir une ambulance à l’entrée de chez toi pour une raison que tu ne comprendras vraiment que bien plus tard.
La fracture de l’oeil quand Jennifer Connelly émerge de l’eau dans the Hot Spot (Dennis Hopper). Elle a bouffé le film par sa présence érotique.
Les première fois où tu fais l’amour en te disant c’est plus compliqué quand y’a pas de montage. Les fois où tu t’abandonnes. Quand tu découvres Anomalisa (Charlie Kaufmann) et enfin ça ressemble à ton expérience.
Quand tu croises des groupes, des communautés dont les espoirs, les utopies, les désirs et les ambitions te poussent. Alors tu files un coup de main, tu crois, tu participes… Et puis Max le fou en toi, solitaire, abandonné te rappelle à l’ordre. La route. Ni regret, ni espérance.
Et puis la fois où tu comprends que tu te rêvais Tarantino et qu’en fait t’es Rick Dalton. Et que c’est déjà pas si mal parce que le conte de fées est toujours possible.
C’est pour toutes ces raisons et milles autres encore que j’aime le grand écran. Pas parce que le cinéma ne me sert qu’à afficher fièrement sur ma bobine mes préférences morales. Le cinéma circule dans mes artères. Il est mon Gandalf surgissant toujours au bon moment pour relancer ma quête. Il m’asperge d’hectolitres d’hémoglobine en rigolant comme un tordu dans Evil Dead 2 de (Sam Raimi) ou Brain Dead (Peter Jackson), jouissant de la blague qu’il vient de me jouer.

Il est ma Paperhouse (Bernard Rose), l’endroit où se jouent et se débattent mes conflits intimes, mes doutes et mes désirs, mêmes les plus tordus et mes peurs. Mon guide, mon Yoda, mon Keyser Söze, mon Cole.
Ouais le cinéma, c’est le monde au-delà du monde, le réel sublime, le fantastique quotidien. Ce qui nous lie par-delà les mots.
Enfin c’est le cinéma que j’aime. Celui qu’on regarde ensemble, en salle.
Parce que j’ai traîné dans les salles de cinéma comme certains traînent au centre commercial. Je suis tombé amoureux déguisé en Batman. J’ai fumé comme John Mac Lane, j’ai essayé de faire du nunchaku comme Bruce Lee puis j’ai abandonné en me faisant défoncer la gueule sur le macadam par des légionnaires éméchés. J’y ai pris des bitures avec des potes en matant Massacre à la tronçonneuse 3. J’ai trainé comme le Toto de Cinéma Paradiso (Guiseppe Tornatore) dans la cabine de projection, émerveillé et hypnotisé par le défilement de la pellicule. J’ai passé la nuit seul avec mon pote dans la salle à mater des films en sirotant des whiskys. Je me suis endormi devant Ghost in the Shell : innocence (Mamoru Oshii), j’en ai rêvé la moitié et je me suis réveillé en reprenant pepouze le fil de l’histoire. Bon, j’ai compris le film plus tard en le renvoyant. Je me suis fais virer du palais des festivals à Cannes pendant la diffusion d’un film de Manoel De Oliveira. J’ai déjeuné, dîné dans la salle pendant les projections à Gérardmer. J’ai passé une nuit entière à fouiller dans 30 ans d’affiches de films avec le même poto projectionniste. J’ai aimé presque tous les films du festival Hallucinations Collectives parce qu’ils ont ouvert plein de nouvelles fenêtres.

La moitié de ma vie, je l’ai vécu pleinement, intensément et amoureusement au cinéma.
Pour l’autre moitié je fais ce que j’ai pu. Alors que l’avenir des salles reste incertain et même si depuis l’annonce du Président l’avenir du cinéma n’est pas définitivement cramé, je suis nostalgique et inquiet. Ben ouais, désolé mais j’ai autant de mal à traîner sur Netflix que dans les rayons d’un Vidéo Futur. Il y a eu des vrais vidéo-clubs dans lesquels ont grandit les cinéastes d’aujourd’hui. J’avais le mien, le Planète Vidéo à Dijon. Le meilleur vidéo-club dans lequel j’ai squatté parce qu’on pouvait parler des heures avec les personnes qui bossaient là-bas. C’est fini. Une époque s’achève silencieusement, dans les salons confinés.
Et je ne peux me résoudre à ce que l’aventure presque érotique de partager un expérience intime collectivement devienne un moment d’onanisme, même si de temps en temps… Bon, c’est mieux que rien.
Avant on allait au Cinéma. Pendant le confinement le Cinéma est venu s’installer dans nos chaumières, un peu à l’étroit, certes, mais tous les professionnels du milieu ont proposé leurs films, longs et courts pour nous aider à supporter cette période, milles mercis à eux. Les plateformes V.O.D se sont régalé, les sites de streaming ou de piratage certainement aussi. Mais pendant ce temps-là, le Cinéma fânait dans le seul endroit où normalement éclosent ses plus belles fleurs.
Et maintenant qu’on ne sait toujours pas quand rouvriront les cinémas, si ils rouvriront pour certains. Comment va t’on rêver ?
Rêver. Pas se bercer d’illusions qui enferment notre imaginaire. Qui le flattent pour mieux le conditionner. Rêver au-delà des cadres, des algorythmes et des masques.
Rêver en grand écran, à plusieurs.
Bon, pendant qu’on y est. Parce que c’est l’endroit et parce que une fois n’est pas coutume je vais aborder un documentaire pour préparer gentiment le retour au monde réel.


Hypernormalisation – 2016
Adam Curtis
Il est dispo sur You Tube en free.
Et il s’appelle Hypernormalization de Adam Curtis. C’est un documentaire, peu connu en France, produit par la B.B.C.
Il est maintenant sous-titré ce qui permet de mieux comprendre l’ampleur de ce qu’il raconte.
Dans les années 80, ceux qui dirigeaient l’Union Soviétique avaient cru qu’ils pouvaient planifier et gérer un nouveau genre de société socialiste. Ils ont découvert que c’était impossible de tout contrôler et de tout prévoir. Mais plutôt que de l’avouer, ils ont prétendu que tout se déroulait selon le plan. L’Union Soviétique devint une société factice où tout le monde savait que ce que leurs dirigeants déclaraient n’était pas réel parce qu’ils pouvaient le voir avec leurs yeux mais tout le monde devait jouer le jeu et prétendre que c’était réel parce que personne ne pouvait imaginer une alternative. Un écrivain soviétique nomma ceci l’Hypernormalisation. Quand vous faites tellement partie d’un système qu’il est impossible de voir au-delà. Le faux devient la norme.
Extrêmement documenté, ce film nous décrit comment la complexité du monde réel a été remplacée peu à peu par une version plus simple, voire simpliste. Pourquoi ? Je vous laisse découvrir cette oeuvre majeure et vous constituez votre opinion. Attention, ce film n’est en rien un truc complotiste . Adam Curtis travaille dans le documentaire depuis 30 ans, il a mené une enquête passionnante qui semble être la somme du travail qu’il a fourni durant toutes ces années. C’est à voir d’urgence pour ne pas se perdre en chemin.
Je reste même étonné qu’il n’aie jamais été diffusé en France (à ma connaissance en tout cas) tant il met le doigt sur ce qui s’avère être un noeud essentiel du monde contemporain.
A voir, à montrer, à discuter…
Et puis parce que c’est Cyberpunk et que j’ai oublié de le citer alors que c’est l’un de mes films préférés.
D’ailleurs j’ai honte de ne pas l’avoir cité dans la descendance de Blade Runner… Shame et contre shame.


Dark City – 1998
Alex Proyas
J’ai presque honte.
Ne pas l’avoir cité dans la descendance de Blade Runner… Shame et contre shame. Dark City, c’était mon Shell Beach. Le rêve poursuivi avec ferveur de voir le film qui synthétiserait mes fluctuations artistiques de l’époque. Qui enterrerait toutes mes attentes, les arroserait de son univers magistral pour les faire repousser plus vivaces, et plus résistantes. Le film est une graîne mutante qui puise profondément ses racines dans la science-fiction d’une génération entière. Une créature protéiforme et virale qui a absorbé ses multiples origines pour renaître dans un néo-polar hallucinant.
Aux confins des genres et d’une ambition artistique remarquable, l’intrigue de Dark City nous colle aux basques de John Murdoch, personnage amnésique, potentiellement meurtrier, se réveillant dans une ville perpétuellement plongée dans les ténèbres. Plus encore que dans Blade Runner, la ville est ici un personnage essentiel. Hors du temps, d’une architecture destructurée quelque part entre le Gotham baroque de Batman, les toiles de Edward Hopper, le Métropolis de Fritz Lang et La Cité des enfants perdus de Caro et Jeunet. Elle est congelée dans les années 40. Enfin… Elle est une part de l’expérience des Étrangers. Des êtres habillés tous pareils, silhouettes maléfiques, répondant aux noms de M. Rapide, M. Visage, M. Livre (beaucoup plus flippants que dans les petites BDs de M. Bonhomme). Les Étrangers sont à la poursuite de John Murdoch parce que le bruit court qu’il aurait le pouvoir de synthoniser (harmoniser). En dire plus serait gâcher le plaisir immense à découvrir cette oeuvre majeure de la science-fiction.
Dark City est sorti un an avant Matrix. Si on compare les deux on peut trouver pas mal de similitudes. Est-ce à dire que Matrix a allègrement pompé Dark City ? Esthétiquement et thématiquement les deux films se chevauchent de bien des façons. Peut-être, comme c’est souvent le cas, qu’une idée n’appartient à personne, elle devient inévitable à un moment et plusieurs la perçoivent et s’en emparent. Personnellement, je préfère Dark City.
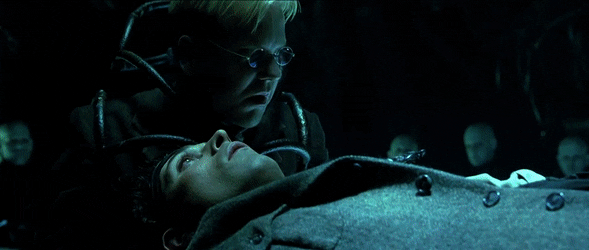
La cité noire en expansion, mutation perpétuelle, les étrangers, leurs silhouettes anxiogènes. L’impression de voir un film profondément pulp. Complètement original et profondément ancré dans l’inconscient collectif de la culture populaire. Réjouissant dans toutes ses idées, Dark City cultive le pouvoir de la fiction comme un moteur de son histoire et nous incite à tous chercher notre Shell Beach.
Il est réalisé par Alex Proyas et c’est sans conteste son chef d’oeuvre. Et même s’il n’atteindra jamais plus de tels sommets cinématographiques, grâce lui soit rendue d’avoir accoucher d’un tel film. Et puis il y a Rufus Sewell, toujours impeccable, Kiefer Shuterland qui joue un docteur Schreber délicieusement fourbe, William Hurt en policier méfiant et Jennifer Connelly, parfaite (j’ai envie de dire comme d’habitude mais je ne suis pas complètement partial) en femme totale ; fantasme, femme amoureuse, délaissée, combattante…
Dark City synthétise le meilleure de la culture Cyberpunk dans un néo-polar de littéraire en empruntant autant à Philip K.Dick qu’à Akira et Rêve d’enfants (le manga D’Otomo). Le mystère d’un épisode de la quatrième dimension. Le plaisir éprouvé à la lecture d’un vieux EC-Comics tordu qui nous transporte l’espace d’un instant dans un univers étrange, à la fois attirant et angoissant, fascinant parce qu’il s’adresse à quelque chose d’intime et profondément enraciné en nous.
Soyez forts, lucides et utopiques.
Tony Gagniarre
Mai 2020