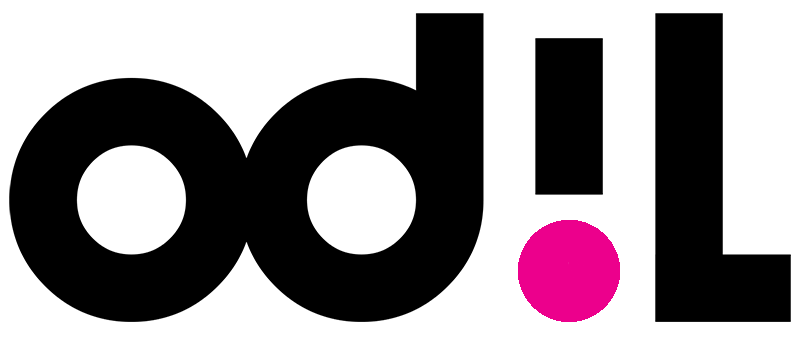Bon, ça y est. On est tous déconfinés.
Prêts à démarrer cette nouvelle période de l’histoire humaine. Comme tout le monde, la plupart, j’ai fait les efforts nécessaires, j’ai écouté, respecté. En tout cas les soignants et toutes les personnes qui ont donné d’eux-mêmes pour que la société continue de tourner. J’ai entendu pas mal de conneries, essayé de faire le tri. Puis j’ai repris le boulot, espérant que l’expérience aurait valeur d’enseignement. Et puis…
Et puis l’arythmie a fait place au rythme inexorable de la société. Et tout est redevenu rapidement très étouffant. Et je suis un peu perdu, désorienté, déçu peut-être. Faut dire, je suis un gars naïf.
J’ai cru, un court instant, que « le changement c’est maintenant », pour reprendre le slogan aussi moisi que les trous du roquefort.
On m’a vendu un reboot et j’ai constaté un vague remake…
Alors le déconfinement est un reboot de la société ? Ou un remake ?
Vous savez, au cinéma, un reboot, c’est presque comme un remake, on prend les mêmes personnages mais on dessine une narration complètement différente du film original. Plus adaptée à l’époque et aux spectateurs, le reboot adopte des thématiques plus en adéquation avec les questionnements de la société contemporaine. Et peut réinventer la trame entière d’un film. C’est une nouvelle version à partir d’un thème connu qu’on essaye d’effacer en prônant une approche radicalement nouvelle… Oui, bon.

Et un remake, me direz-vous ?
La différence, subtile je vous l’accorde, étant qu’un remake reinterprète une histoire définie. Il l’a refait. Par exemple, le chef d’oeuvre de John Carpenter : The Thing (1982) est un remake du film de Howard Hawks et Christian Nyby : The thing from another world (1951) et le film de Matthijs van Heijningen Jr : The Thing (2011) est lui-même… Oubliable.
Les remakes sont légions et existent depuis que le cinéma existe. Ils font partie de son ADN. Parce que le regard sur une oeuvre de fiction évolue, parce que les techniques de réalisation évoluent et permettent d’envisager certaines idées impossibles il y a quelques années ; parce que des réalisateurs s’emparent d’un sujet qui les a touchés pour en donner une approche personnelle. Alors parfois on préférera oublier poliment certains remakes…

À part pour déconner entre potes, faut-il se rappeler du remake de King Kong réalisé en 1976 par John Guillermin ?
Loin de tutoyer le classique et culte film de 1933 réalisé par Merian C.Cooper et Ernest B. Schoedsack, ce King Kong est un nanar tout juste amusant avec un homme en costume qui joue largement moins bien que Godzilla et une grosse main mécanique qui chope Jessica Lange pour essayer de lui faire subir les derniers outrages zoophiles. Mais en 2005, le King Kong de Peter Jackson remet les pendules à l’heure. Aventure, action débridée, exotisme, charisme dingue du roi Kong, émotion à fleur de peau… Le King Kong de Peter Jackson est un chef d’oeuvre en même temps qu’une oeuvre essentielle dans sa filmographie parce que c’est le film de 1933 qui lui a donné envie de faire du cinéma.
D’autres remakes pointent régulièrement le bout de leur nez dans les salles obscures. Et la liste est bien trop longue pour la dresser de manière exhaustive. Voici quelques exemples pour la forme.

En 1986, David Cronenberg efface quasiment La Mouche Noire (1956) de Kurt Neumann des mémoires en réalisant l’un de ses nombreux chefs d’oeuvres : La Mouche. Un film qui colle salement à son époque en abordant sans détour la dégradation physique et mentale du personnage.
La mouche est une histoire sombre, féroce et morbide qui transcende son sujet par son approche fantastique. Elle s’inscrit dans son époque en évoquant le spectre du SIDA et le scandale du sang contaminé. En y greffant ses interrogations personnelles ; le physique comme une extension du mental, le pouvoir de la science et des technologies, la force et l’impuissance de l’amour ; Cronenberg créait une oeuvre majeure à la fois totalement personnelle dans ses enjeux et totalement fédératrice dans son traitement.

1983, Brian De Palma, au sommet de son art, marque le cinéma et le monde du hip hop avec son film légendaire Scarface.
Remake du Scarface de Howard Hawks de 1932. L’histoire du film original raconte comment un immigré bâtit un empire sur le trafic d’alcool à Chicago pendant la prohibition. Elle évoque à demi-mots l’ascension d’Al Capone. Celle du film de De Palma garde la même ligne narrative. L’alcool est remplacée par la cocaïne. Et prend comme base un fait historique de l’époque : l’Exode de Mariel. En pleine guerre froide au début des années 80, le régime de Fidel Castro expulse 125 000 Cubains considérés « contre-révolutionnaires » entre avril et septembre 1980. Ils partiront du port de Mariel pour débarquer sur les côtes de Floride. Dans le film, Tony Montana fait partie de ces émigrés cubains. La légende est en marche, le monde est à lui.

Plus récemment en 2004, Zack Snyder réalise L’armée des morts, remake du film culte Zombie (Dawn of the dead) de George A.Romero.
Faire un remake de Zombie pour beaucoup c’est une hérésie, c’est comme se tirer une balle dans le pied au shotgun.
Mais Zack Snyder est malin. Il dégraisse la charge sociale de l’original pour accoucher d’un survival bourrin et énervé. Puis il reprend une idée forte du film 28 jours plus tard de Danny Boyle ce qui deviendra source de bien des polémiques dans les milieux interlopes.
Face à ses réussites, nombreux sont aussi les échecs. Le Carrie, la vengeance de 2013 de Kimberly Pierce a une bien belle affiche.
Mais c’est à peu près tout. Rien n’a voir avec Carrie au bal du diable (1973) de Brian De Palma. Le remake du Fog de John Carpenter (1980)…
Si, si y’a eu un remake en 2005, réalisé par Rupert Wainwright, qui a probablement enterré sa carrière bien profond avec cette tentative dispensable…
Alors bien sûr, personne n’aime qu’on touche à une oeuvre qui le touche, l’émeut ou le bouleverse. Mais les remakes peuvent être un point d’entrée interessant dans l’histoire du cinéma.
On peut comparer les différentes versions d’une oeuvre. Leurs points de convergence, les changements. Comment l’oeuvre s’inscrit dans son époque. Et ce que la nouvelle version apporte par rapport à l’original et redéfinit sa thématique.

Il y a eu 4 versions de l’invasion des profanateurs de sépultures :
En 1956, L’invasion des profanateurs de sépultures (Invasion of the body snatchers) de Don Siegel.
En 1978, L’invasion des profanateurs (Invasion of the body snatchers) de Philip Kaufman.
En 1993, Body Snatchers de Abel Ferrara.
En 2007, Invasion (The Invasion) de Olivier Hirschbiegel.
Le premier dénonçait déjà l’uniformisation de la société et son apathie et même si Don Siegel c’est toujours défendu d’avoir voulu faire de la politique, on ne peut s’empêcher d’y voir une critique du Maccarthysme. Dans les années 50, la guerre froide contre la Russie engendra une effroyable peur du communisme qui déboucha sur une « chasse aux sorcières » durant laquelle plusieurs millions d’américains furent traqués, interrogés et enfermés – De nombreux artistes travaillant dans le cinéma durant cette période furent soupçonnés d’être des agents ennemis : Charlie Chaplin, Jules Dassin, Dalton Trumbo, John Berry….
La version de Philip Kaufman, qui reste la meilleur avec celle de Don Siegel, marche au départ dans les traces de son prédécesseur mais pousse tous les curseurs de la paranoïa pour en faire une oeuvre d’une noirceur absolue. Parce que dans cette version l’ennemi est à l’intérieur, c’est l’individu qui s’abandonne à l’uniformisation. Le film arrive à la fin de l’âge du nouvel Hollywood dans une période particulièrement troublée des Etats-Unis. C’est la fin de l’utopie Hippie, ils se rangent et intègrent la société de consommation et la plupart abandonnent le combat…
Ou ils vont le situer sur un autre terrain : l’économie. La fin glaçante du film de Kaufman annonce l’apocalypse qui vient.
Body Snatchers sera le premier et dernier film d’Abel Ferrara dans le genre purement fantastique.
Il revient plus ou moins avec The Addiction qui traite du vampirisme comme une addiction. Des drogués du sang, une bonne idée qui s’égare dans la vanité intellectuelle du propos. Body Snatchers est un échec. Pourtant l’enveloppe reste belle, Ferrara propose des images tétanisantes et plusieurs bonnes idées : Il fait du film un huis-clos se déroulant dans une enceinte militaire et fait directement référence à la guerre du Golfe, aux enjeux militaro-industriels de l’ère post-reagan (encore une sale époque de l’Amérique), multiplie les points de vue et soigne les séquences gores. Mais sans être un ratage, le film ne prend pas totalement aux tripes en comparaison de ses aînés.
Pour la version de 2007, je ne l’ai vu qu’une fois et j’en garde un souvenir moins que mémorable et aussi vague qu’un clapotis dans une mare.
Y’a Nicole Kidman. Et Daniel Craig.
Pour peu qu’un remake soit à peu près réussi…
Même pas forcément en fait, il nous pousse toujours à nous interroger sur l’époque de sa réalisation. Par ses choix de mise en scène, sa narration et comment il raconte et interprète une histoire déjà connue.
J’apprécie les remakes pour ces raisons et quand je sais ou j’apprends qu’un film est un remake, j’essaye de voir l’original ou le remake, selon.
Récemment j’ai découvert Le convoi sauvage (Man in the wilderness – 1971) de Richard C.Sarafian ; le réalisateur de l’excellent Point Limite Zéro (je vous remets plus bas un petit avis sur ce film météor que j’ai écrit y’a pas très longtemps).
Pour ceux qui auraient la chaîne, je l’ai vu en replay sur TCM cinéma.
The Revenant (2015), le film d’Alejandro Gonzales Innaritu avec Leonardo Di Caprio est un remake du Convoi Sauvage.
Autant le dire, j’avais modérément apprécier The Revenant. La mise en scène m’as-tu-vu, faussement immersive et le jeu tout en morve et raclements de Leonardo me faisait régulièrement sortir du film. Comme si le réalisateur filmait et commentait en même temps ses images : Regardez, y’a personne ! Je peux faire des panos à 360° et y’a personne. Mais je peux aussi faire des plans séquences de malade avec un cheval qui tombe d’une falaise parce que bon j’ai quand même de la thune pour vous en mettre plein la vue. Jusqu’au plan final (je ne le révélerai pas parce que le film n’est pas une abominable purge et mérite qu’on s’y attarde un peu) qui m’a carrément énervé parce qu’il reflète à mon avis, le désir du réalisateur et de l’acteur en faisant ce film.
Les 2 films s’inspirent de la vie de Hugh Glass, un trappeur américain qui, après avoir été salement amoché par un grizzli furieux a été abandonné en pleine nature par ses compatriotes de la compagnie de fourrure des montagnes rocheuses. Mais il survivra et après un calvaire de six semaines, il réussit à rejoindre le fort Kiowa à 300 kilomètres. Son histoire a été racontée dans de nombreuses ouvrages dont celui de Michael Punke, The Revenant : A novel of revenge sorti en 2002, qui servira de base à The Revenant.

Le convoi Sauvage entretient une relation lointaine donc avec The Revenant.
Il entretient plus de rapport avec le western spaghetti. Voir la trogne impressionnante des comédiens, le capitaine Henry (joué par John Huston quand même) en tête. La crasse, la boue, le côté anti-glamour, la violence et en même temps un rapport à la nature plutôt poétique et des cadres qui dévoilent un paysage grandiose. Bon, vous laissez pas avoir par la scène de l’ours qui a assez mal vieilli et sent le cheap à plein nez. Le film se laisse découvrir agréablement après.
Et l’obsession du capitaine pour son bateau. Un bateau trainé par des mûles au milieu des Apalaches à la recherche d’une rivière fantôme m’a fait penser à Fitzcarraldo, le film fou de Werner Herzog (1982). Enfin l’image du bateau évoluant dans ces territoires montagneux. Peut-être parce qu’il m’a simplement rappelé ce cinéma qui prenait des risques fous, ce cinéma qui osait des paris insensés pour offrir des images uniques qui ne se dissimulaient pas derrière des afféteries techniques. Un cinéma de sueur, de moustaches, de sang rouge et épais (et pas de giclées numériques), un cinéma avec plus de tournage que de post-production. Ceci étant, on peut apprécier les 2 pour des raisons différentes.

La culture populaire est un Ouroboros (c’est le serpent qui se mord la queue).
Ce n’est peut-être pas un hasard si on retrouve ce symbole dans les mythologies égyptiennes, asiatiques, nordiques et aztèques. La culture se nourrit d’elle-même dans un cycle perpétuel de création, digestion, recréation. Elle est cyclique parce que certaines idées et thématiques sont éternelles, ancrées dans notre inconscient collectif. Et voir les différentes versions d’une oeuvre vous permet de vous positionner, de construire votre désir de cinéma, et d’aiguiser votre appétit et d’élargir votre compréhension.
Et le reboot, dans tout ça ?
Est ce qu’il ne serait pas une tentative plus ou moins adroite de masquer les précédentes versions, de simplement les annuler ? On efface ce qui a été fait avant parce que, peut-être que cela menait dans une impasse, parce que tenir compte de l’évolution d’un personnage, d’un contexte limite les possibilités créatives.
Le concept du reboot semble être né dans les années 2000. Il n’existe pas de films qui soient considérés comme tel avant. Le reboot ne serait-il pas simplement une forme de novlangue (1) ? Une formule adroite pour relancer une idée que plusieurs remakes, sequels (suites) ont épuisé.

La trilogie Batman de Christopher Nolan est un reboot.
C’est à dire qu’elle oublie les films de Tim Burton et Joel Schumacher, et Christopher Nolan reprend l’histoire de Batman à zéro. Il créait une nouvelle storyline qui prendra la forme d’une trilogie. Avant qu’une nouvelle apparition du personnage voit le jour dans les films de la franchise DC. La trilogie assèche l’approche gothique et expressionniste développé par Tim Burton. Batman devient un genre de super soldat, toujours torturé et tiraillé entre le bien et le mal, la justice d’un pays et la notion de justice d’un homme. Les ennemis de Batman sont plus là pour éprouver ses dilemmes et on pourrait reprocher à cette trilogie cette approche parfois trop métaphorique qui oublie de donner de la chair à ses méchants. Exception faite de l’interprétation géniale du Joker de Heath Ledger.
Dans les films de Tim Burton ; je passe sous silence poliment les films de Joel Schumacher qui revisitent l’approche pop et bariolée de la série des années 60 ; Batman est un personnage presque secondaire. Burton s’intéresse aux psychopathes qui peuplent son univers, aux freaks. Et dresse un tableau touchant de Catwoman, du Pingouin et de sa clique foraine. Et très clairement, Batman est attiré par les monstres puisqu’il en est un lui-même.

De même chez Nolan, GothamCity n’est plus la ville gothique écrasante influencée par le Métropolis de Fritz Lang, le constructivisme russe, l’art déco et l’art nouveau pour redevenir ce qu’elle était à l’origine, une excroissance malade de New-York. Les méchants deviennent plus réalistes, on pourrait presque les croiser dans la rue. Bon si je croise un gars avec la gueule du Joker de The Dark Knight il est possible que je m’enfuis en pleurant. Ce qui n’empêche pas que le Pingouin dans Batman le défi (1992) reste l’un des plus beaux personnages de la filmographie Batman. Et dans les 2 séries, le deuxième film est le meilleur. Batman le défi et The Dark knight (2008) sont des oeuvres majeures qui ont définitivement installé le chevalier noir dans la tête des spectateurs. Pour autant la trilogie de Nolan arrive après le 11 Septembre, le terrorisme, la mise à jour du capitalisme effréné, la lutte des classes. Il le fait parfois avec des gros sabots ; surtout dans The Dark knight Rises avec le personnage de Bane, traité un peu par-dessus la jambe par rapport au Comics dont il s’inspire : Knightfall, un vrai chemin de croix pour le chevalier noir qui se fait littéralement brisé par Bane, et une oeuvre majeure dans l’histoire du personnage dans les Comics. Au même titre que The Dark Knight Returns, le chef d’oeuvre inégalé de Frank Miller sorti en 1986 et qui redéfinira dans les Comics le personnage mais fera aussi passer les comic-book dans son ère « mature » et respectable. Une date.
L’autre série ayant redéfinie le genre à cette époque s’appelle Watchmen d’Alan Moore. Dont le film de Zack Snyder effleure toute la puissance de frappe sans jamais arriver à sa cheville. Préférez quoiqu’il arrive la director’s cut qui redonne un peu plus la saveur du comic-book. Regardez le film, s’il vous plaît, lisez la BD. Même s’il ne vous plaît pas. Alan Moore est un génie. Le Shaman de la culture populaire. Je reviendrais obligatoirement sur ce personnage qui a laissé tous les droits des adaptations de ses histoires aux dessinateurs car il n’a jamais voulu avoir rien à faire avec l’industrie du cinéma.

D’autres films ont eu droit à leur reboot.
La trilogie La planète des singes : Origines (2011-2014-2017) de Matt Reeves, qui réussit à être aussi bonne que la première série de films de 1968 à 1973. Pour mémoire, il y a eu 5 films. Les 3 premiers sont des chefs d’oeuvres à voir et revoir, les 2 suivants méritent le détour.
La planète des Singes (planet of the Apes, 1968) – de Franklin Schaffner
Le secret de la planète des singes (Beneath the Planet of the Apes, 1970) – de Ted Post
Les évadés de la planète des singes (Escape from the planet of the Apes, 1971) – de Don Taylor
La conquête de la planète des singes (Conquest of the planet of the Apes, 1972) – de Jack Lee Thompson
La bataille de la planète des singes (Battle for the planet of the Apes, 1973) – de Jack Lee Thompson

Les films de Matt Reeves se placent dès le départ dans une forme de continuité mais ils adoptent le point de vue des singes et ne le quitteront jamais. En prenant le parti de raconter l’histoire par ce biais, le développement de l’intelligence chez les singes, la création de leur société, la guerre contre les humains pour trouver leur liberté et annoncer un futur prophétique sombre pour la race humaine, elle raccroche miraculeusement au film de 1968 réalisé par Franklin Schaffner et évite la comparaison avec son final anthologique impossible à reproduire. Tim Burton s’y était d’ailleurs gentiment cassé les dents dans son remake en 2001 sobrement intitulé La Planète des singes.

Les deux trilogies ne se copient pas, elles se nourrissent l’une l’autre avec comme point d’orgue indépassable la scène finale du film de 1968. La série de films originaux et les reboots ont également en commun leurs aspects métaphoriques et satiriques. Tous évoquent et moquent d’abord les comportements humains, la religion, l’oppression, l’aveuglement, le racisme, la violence et l’affrontement comme seule issue pour régler un conflit. Triste quand on y pense qu’un film de 2018 ne puisse que renvoyer dans son final à un autre de 1968.
D’autres reboots apportent un éclairage intéressant sur des mythologies cinématographiques.
Le Man of Steel de Zack Snyder (2013) qui fait du personnage de Superman un vrai demi-dieu, à la fois charismatique et inquiétant. Un personnage que tout le monde cherche à utiliser pour son propre bien-être et qui choisira de se dissimuler pour mieux servir et ne pas être au service.
Une approche intéressante. Et puis des ratages quand même : Freddy : Les griffes de la nuit (2010), Terminator Genisys (2015), Spiderman : Homecoming (2017)…
Bon, alors la société post-confinement, remake ou reboot ?
Je vais être honnête. Je ne suis pas sûr que la comparaison entre le cinéma et la société tienne la route, qu’elle soit même justifiable.
Toutefois, comme je n’ai aucun amour propre, je vais continuer. Les événements qui se déroulent actuellement laissent une sale impression de déjà-vu, toutefois certains détails diffèrent et me laisse un sentiment plutôt positif. Lointain, c’est sûr ! Parce qu’on n’a pas le cul sorti des ronces, mais bien présent. Le monde évolue grâce aux personnes qui sont prêtes à faire tomber les idoles, les traditions, l’indifférence, le racisme et l’individualisme.
« Le progrès n’est pas le changement mais la capacité à se souvenir.
Georges Santayana (2) – Vie de raison (1905)
Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter ».

Il faut regarder l’histoire à la lumière du présent. Ne pas essayer de l’effacer, de s’en extraire comme si nous n’étions pas responsables comme le suggèrent certains connards. Nous sommes les descendants de l’histoire, les constructeurs du futur.
Alors ni remake, ni reboot.
Mais peut-être que comme le disait Bruce Campbell à propos d’Evil Dead 2, la société post confinement est une requel. C’est à dire à la fois un remake et une sequel. On reprend une partie de l’histoire, on la refait mais elle évolue. L’histoire continue.
Et si vous avez réussi à lire jusque là.
BONUS STAGE !
Je vous en parlais plus haut. Point Limite Zéro de Richard C.Sarafian

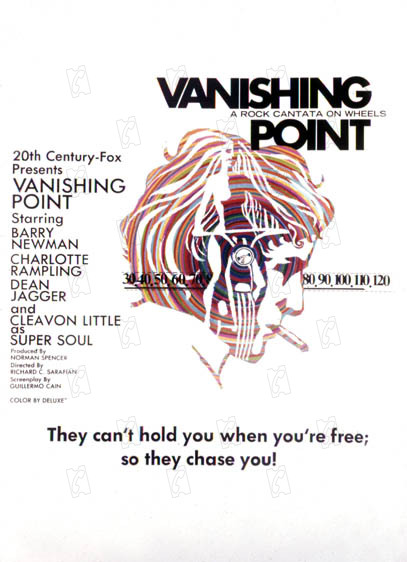
Richard C. Sarafian COLLECTION CHRISTOPHEL
Vanishing Point est un film culte pour George Miller et Quentin Tarantino dont j’avais bien entendu parlé de nombreuses fois. Le titre m’intriguait au plus haut point et excitait ma curiosité…
Kowalski, c’est le père caché de Max le fou et de Stuntman Mike et de ses 3 proies Arlène, Shanna et « Jungle » Julia.
C’est le dernier héros américain comme le dit son guide, un Disc Jockey noir et aveugle du nom de Super Soul qui balance une pure bande son pour rythmer le périple de son héros.
Kowalski, donc, pilote une Dodge Challenger Blanche pour rallier en quinze heures Denver à San Francisco, soit un peu plus de 2000 kms (merci Ecosia. Cultivez-vous et plantez des arbres ! ). Y’a-t’il besoin d’en dire plus ?
Un road trip à 200 à l’heure qui ne dément jamais son idée de départ. Qui nous balade dans les paysages grandioses, les routes qui n’en finissent pas, les déviations se perdant dans le désert du Nevada au son d’une musique Soul. Un film à la rencontre de l’Amérique libre et libertaire des années 70. Mais pas de discours ici, un mec qui taille la route, mange le bitume en essayant d’échapper aux flics et en croisant sur son chemin, des hommes et des femmes cools (souvent dénudées, ok) qui vont lui filer un coup de main. Au cours de son périple, on en apprend un peu plus sur le passé du personnage et se dessine en creux l’image d’une certaine amérique détestable qui le poussera finalement à atteindre ce point limite. C’est l’histoire d’une époque qui vit ses derniers instants, mais qui les vit intensément sans jamais abandonner ses idéaux quitte à…
Point Limite Zéro est un pur film cinétique. Un film sur le mouvement, la vitesse. Une oeuvre majeure de la série B ayant très certainement influencé l’un des plus grand films de cette décennie.
Authentiquement cool. Du cinéma, putain !
Tous les films cités se trouvent sur plateforme S.V.O.D ou dans de superbes éditions collectors. À vous de jouer.
Tony Gagniarre
Juin 2020

(1) « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées […]. Le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n’y a plus, dès maintenant, c’est certain, d’excuse ou de raison au crime par la pensée. C’est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. […] Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l’ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n’existeront plus qu’en versions novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque-chose de différent, ils seront changés en quelque-chose qui sera le contraire de ce qu’ils étaient jusque-là. Même la littérature du Parti changera. Même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « La liberté c’est l’esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli ? […] En fait, il n’y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n’a pas besoin de pensée, l’orthodoxie, c’est l’inconscience. »
Syme, un fonctionnaire mettant au point la novlangue en exprime le sens précis. 1984 – George Orwell
(2) « Cultive l’imagination, aime-la, donne-lui sans fin de nouvelles formes, mais ne la laisse pas te tromper. Apprécie le monde, parcours-le, étudie ses voies, mais ne te laisse pas posséder par lui… Posséder des biens et des choses en idées est le seul bien pur que l’on puisse obtenir ; les posséder physiquement ou légalement est un fardeau et un piège »
George Santayana est un écrivain et philosophe américano-hispanique de langue anglaise, né à Madrid en 1863 et mort à Rome en 1952.